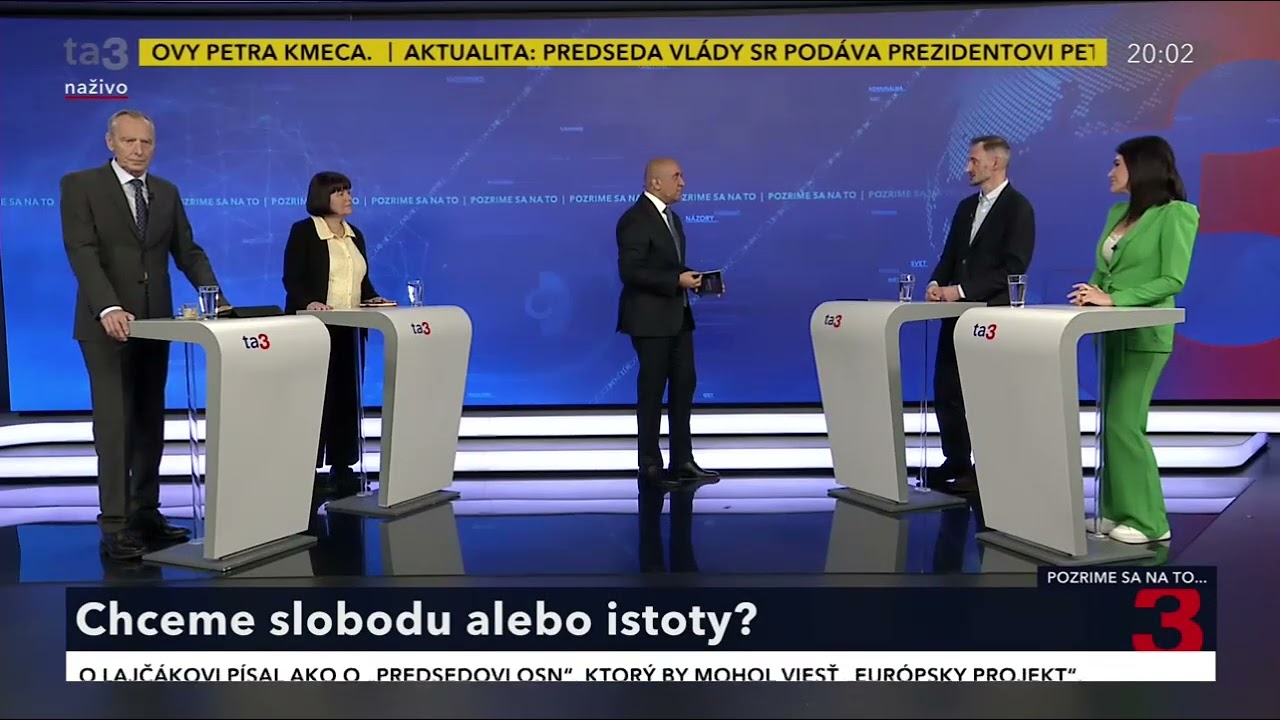Portrait dans la foi Jan Figel a l’allure d’un homme qui n’est ni pressé ni facilement déstabilisé. Il porte en lui l’assurance tranquille de celui qui a passé des décennies à mener des négociations complexes, à façonner des cadres délicats et à défendre, discrètement mais fermement, ceux dont la voix a été réduite au silence. En tant qu’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction, Figel est devenu un pilier dans le domaine souvent controversé et complexe des droits religieux internationaux. Son œuvre, marquée non par la rhétorique mais par l’action pragmatique, témoigne de la puissance d’une diplomatie durable et fondée sur des principes face aux plus grandes injustices du monde.
Né en Slovaquie, Figel a grandi dans une Europe à la croisée des chemins, où les forces de l’histoire, de la religion et de la politique s’entrechoquaient et où l’aspiration à davantage de libertés individuelles venait tout juste d’émerger de l’ombre du joug soviétique. C’est dans ce contexte qu’il a développé très tôt un intérêt pour les droits de l’homme, en particulier la liberté religieuse, une préoccupation qui allait guider sa vie professionnelle. Après des études à l’Université de Bratislava et l’obtention d’un diplôme de droit, la voie de Figel vers la politique et la diplomatie s’est imposée comme une évidence, car son sens de la justice et sa conviction du droit fondamental de chacun à suivre sa conscience étaient au cœur de sa personnalité.
À la fin des années 1990, la Slovaquie sortait de décennies de régime totalitaire soviétique, et Jan Figel s’est impliqué dans le système politique slovaque alors que le pays naviguait vers son indépendance nouvellement acquise. Le début de sa carrière politique a été marqué par sa détermination à contribuer à l’édification d’une société où la liberté d’expression et la liberté de croyance seraient des droits fondamentaux, et non des privilèges ou des anomalies. Pour Figel, la liberté religieuse a toujours dépassé les limites étroites de la foi personnelle ; pour lui, il s’agissait de l’architecture même d’une société libre, de la création d’un espace public où chacun pourrait s’exprimer sans crainte de persécution ou de discrimination.
Jean FigelSon profond engagement envers ces idéaux l’a propulsé sur la scène européenne en 2004, lorsque la Slovaquie a rejoint l’Union européenne. Son ascension a été fulgurante et il a rapidement été nommé ministre slovaque des Transports, des Postes et des Télécommunications. Cependant, son dévouement aux droits de l’homme est resté inébranlable, même dans un rôle qui l’obligeait à se concentrer sur les infrastructures. Lorsque l’occasion s’est présentée de plaider en faveur de plus grandes libertés religieuses sur la scène européenne, il s’est retrouvé à nouveau attiré par le débat mondial sur la liberté religieuse.
En 2016, après avoir été vice-Premier ministre de la Slovaquie et figure emblématique de la diplomatie européenne, Figel a été nommé envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction. À ce titre, il a joué un rôle à la fois de défenseur et de médiateur, naviguant dans des eaux internationales délicates où les libertés religieuses sont menacées par des régimes autoritaires, des idéologies radicales et une intolérance croissante.
Au cœur du travail de Figel se trouve la conviction que la liberté religieuse est inextricablement liée à la santé de la démocratie elle-même. Dans les pays où les droits religieux sont menacés, ce n’est pas seulement la foi qui en pâtit, mais le tissu social tout entier. Privés de la possibilité de croire librement, privés de l’espace nécessaire pour pratiquer et exprimer ouvertement leur foi, les individus sont privés d’un aspect essentiel de leur humanité. C’est cette conviction qui a fait de Figel un défenseur infatigable des droits des communautés religieuses minoritaires, en particulier dans les régions où ces communautés sont les plus vulnérables.
Son approche de la diplomatie est unique. Tandis que d’autres crient ou font appel à l’émotion, la méthode de Figel s’apparente davantage au travail patient d’un médiateur. Il a toujours été quelqu’un qui recherche un terrain d’entente, qui recherche les occasions de construire des ponts plutôt que d’abattre des murs. Dans les couloirs des Nations Unies, lors des conférences de défenseurs de la liberté religieuse ou lors des rencontres avec des diplomates étrangers, la voix de Figel est calme mais ferme, posée mais inébranlable. Ce n’est pas un homme politique qui cherche à dominer le débat, mais plutôt quelqu’un qui comprend que les meilleurs résultats sont souvent ceux obtenus discrètement, par des négociations réfléchies et un engagement envers des valeurs communes.
L’une des réalisations les plus marquantes de Jan Figel en tant qu’envoyé spécial de l’UE a été son plaidoyer en faveur des minorités religieuses persécutées au Moyen-Orient. La région a connu une montée des violences contre les groupes religieux, en particulier contre les chrétiens, les yézidis et d’autres sectes plus petites, avec l’enracinement des idéologies extrémistes. Figel a porté ces questions à l’attention de la communauté internationale, exhortant les dirigeants européens à prendre position en faveur des minorités religieuses. Ce faisant, il s’est révélé être non seulement un défenseur, mais aussi un traducteur des souffrances du monde, les faisant entrer dans les sphères du pouvoir, veillant à ce que ceux qui sont souvent négligés ne soient pas oubliés.
Mais l’influence de Figel s’étend au-delà du Moyen-Orient. Il a également œuvré sans relâche pour promouvoir la liberté religieuse au sein de l’Union européenne, veillant à ce que les lois et les politiques de l’UE respectent le droit des individus à pratiquer leur foi sans crainte de discrimination. La montée du populisme et du nationalisme en Europe a engendré un climat croissant de suspicion et d’intolérance, les minorités religieuses se trouvant de plus en plus marginalisées. Le travail de Figel dans ce domaine a joué un rôle déterminant pour repousser ces forces, rappelant aux dirigeants européens que la liberté religieuse n’est pas un concept abstrait, mais un pilier fondamental des valeurs de l’UE.
Il a également joué un rôle essentiel dans l’établissement et la promotion du dialogue interreligieux, reconnaissant que la véritable liberté religieuse ne se limite pas aux droits légaux, mais qu’elle favorise un environnement de respect et de compréhension mutuels. Figel a été un fervent défenseur du développement des relations entre personnes de confessions différentes, convaincu que le dialogue et la coopération permettent de trouver un terrain d’entente, même entre les croyances les plus divergentes. Dans un monde de plus en plus divisé par des clivages idéologiques et religieux, l’œuvre de Figel rappelle que la paix ne naît pas de l’absence de désaccord, mais de la volonté de dialoguer et de rechercher la compréhension malgré lui.
Malgré la gravité de son travail, Figel demeure une figure profondément humble. Son attitude est loin du profil typique d’un diplomate ou d’un dirigeant politique. Ses actions sont dénuées de toute grandiloquence ; il semble plutôt plus soucieux des résultats de ses efforts que de leur visibilité. Il est connu pour son écoute attentive, sa capacité à percevoir les non-dits et sa persévérance discrète face aux résistances. Cette humilité, alliée à son engagement indéfectible en faveur des droits humains, lui a valu le respect et l’admiration de ses collègues, même de ceux qui sont en désaccord avec lui sur d’autres sujets.
En se décrivant lui-même, Jan Figel a dit un jour : « Je suis un homme humble et faible au service de Dieu et de mon prochain. » Cette affirmation résume l’essence de sa personnalité : un homme dont le service aux autres ne résulte pas d’un désir de reconnaissance ou de pouvoir, mais d’une conviction profonde et inébranlable en l’importance de servir quelque chose de plus grand que soi. C’est cette humilité qui a façonné toute son approche de la liberté religieuse : il ne se considère ni comme un héros ni comme un sauveur, mais comme un serviteur, œuvrant discrètement pour la justice, sans tambour ni trompette.
Pour Figel, la liberté religieuse n’est pas un idéal abstrait, mais une question de vie quotidienne. C’est une cause à laquelle il a consacré sa vie, qu’il poursuit avec une intensité discrète souvent négligée dans un monde qui privilégie le spectacle au contenu. Son travail ne vise pas la gloire ou le pouvoir, mais vise à garantir que chacun, partout dans le monde, puisse vivre selon ses convictions les plus profondes – sans peur, sans répression et sans violence.
Aujourd’hui, Figel demeure convaincu que la liberté religieuse est essentielle non seulement à l’épanouissement des individus, mais aussi à l’avenir de la société. Son travail continue de façonner les contours de la politique européenne en matière de liberté religieuse, tout en œuvrant discrètement en coulisses pour soutenir ceux dont les droits sont menacés.
S’engager auprès de Jan Figel, c’est rencontrer quelqu’un dont les valeurs ne dépendent pas des vents politiques du moment, mais d’une compréhension plus profonde des luttes mondiales persistantes. Sa diplomatie est fondée sur des principes, non sur des postures ; sur des convictions, non sur des convenances. Dans un monde où règne le bruit, la détermination tranquille de Figel rappelle avec force que la quête de la vérité, de la justice et de la liberté religieuse est un chemin qui exige patience, courage et, surtout, la conviction inébranlable que ces valeurs peuvent et doivent être défendues.
En fin de compte, l’œuvre de Jan Figel ne vise pas la réussite personnelle ou la reconnaissance. Il s’agit de créer un monde où les personnes de toutes confessions, origines et croyances puissent vivre en liberté et en dignité. Et dans cette quête silencieuse, il continue de construire, brique après brique, un monde plus juste et plus pacifique pour les générations futures.